Art politique ou art de désobéir ?
Le 14 février 2013, le sénateur socialiste et ancien secrétaire général du Syndicat de la magistrature Jean-Pierre Michel déclarait : « Ce qui est juste, c’est ce que dit la loi. Voilà, c’est tout. Et la loi ne se réfère pas à un ordre naturel. Elle se réfère à un rapport de force à un moment donné. Et point final. C’est le point de vue marxiste de la loi. » Si, par bien des aspects, ces paroles ont un côté effrayant, elles n’en demeurent pour autant pas si éloignées d’une certaine pratique de la politique. Effrayantes, indubitablement elles le sont, surtout lorsque l’on relit Eichmann (officier nazi qui, lors de son procès, clama n’avoir fait que respecter les lois du IIIe Reich) à Jérusalem : Rapport sur la banalité du mal d’Hannah Arendt, ouvrage ayant démontré les limites du légalisme. Que faire face à une loi injuste ? Constitutionnaliser la désobéissance civile comme le suggérait Hannah Arendt en 1971 afin d’inverser le rapport de force en présence et mieux pallier les carences de la démocratie moderne ?
Si, en France, la désobéissance civile ne fait pas encore partie du bloc de constitutionnalité, au regard de l’histoire du siècle écoulé, il paraît évident que ce mode d’action a été celui qui a été le plus usité pour peser dans le débat public. On peut par exemple penser au travail mené par le Conseil Représentatif des Institutions juives de France en vue de défendre les droits et intérêts de la communauté juive de France, à celui des associations LGBT défendant les homosexuels, à celui des associations venant en aide aux migrants ou encore au mouvement des Gilets jaunes afin de lutter contre la vie chère. Toutefois, l’on peut regretter que les pionniers de ces différents combats aient parfois dû le payer de leur vie ou qu’ils aient été emprisonnés, alors victimes d’antisémitisme, d’homophobie ou de xénophobie.
Au regard de cette réflexion, la question qui se pose est donc la suivante : l’art politique doit-il, dans un premier temps, consister à désobéir, à prêcher dans le désert, à être emprisonné, voire tué, pour pouvoir, par la suite, mieux triompher ?
Que penser aussi des hommes et femmes politiques ayant eu recours à la désobéissance civile durant leur jeunesse, qui, une fois au pouvoir, demandent à leurs concitoyens de ne pas désobéir aux lois qu’ils votent ? Se pose alors un véritable problème de crédibilité de la parole politique…
En outre, cette manière de concevoir la politique comme un art de désobéir, conduit chacun à penser qu’il a raison trop tôt, persuadé que l’histoire lui donnera raison…
Pour conclure, l’on pourrait, à bon droit, imitant Voltaire, écrire que la politique est l’art de désobéir à propos !

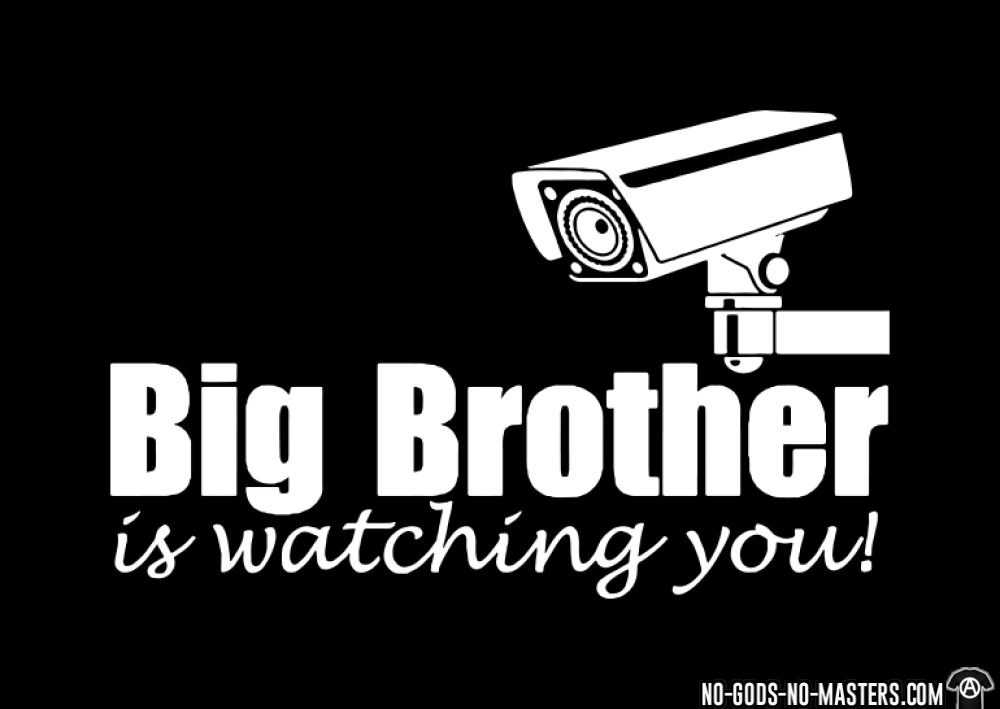




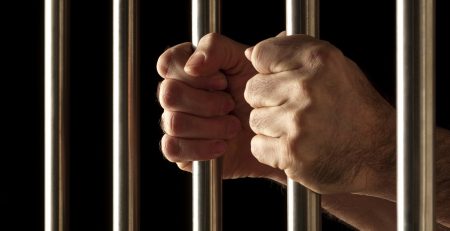



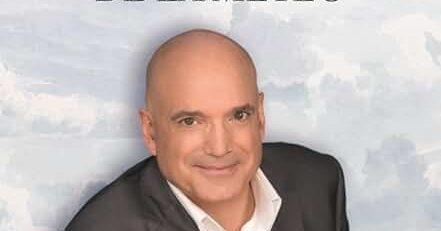

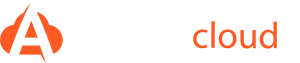
Laisser un commentaire