Démocratie directe : réponse au mal-être français (version intégrale)
Les imposants cortèges d’opposants suscités depuis janvier par le projet macronien de réforme des retraites traduisent à la fois de la colère et un certain désenchantement : celui de n’être pas sûr de peser vraiment sur l’issue.
Faute de référendum et surtout faute de pouvoir l’initier, les manifestants se sentent démunis, voire piégés. En effet, tout ce barnum risque de s’achever pour eux par un vote du Parlement favorable au projet, alors même que l’opinion y est majoritairement hostile. Il est de fait que la probabilité d’un tel vote d’adoption se révèle en dernier lieu assez forte. Une consultation référendaire eût pu permettre d’obtenir un rejet opposable au pouvoir. Certes, ce ne sera pas la première fois que la partitocratie parviendra à imposer un choix en discordance marquée avec le sentiment dominant dans l’opinion. On nous explique que c’est normal. Ainsi va la démocratie française…
En réalité, nos institutions sont affectées par une infirmité dirimante: l’impossibilité pour les citoyens, en dehors des périodes électorales, de peser sur les choix. De dire par eux-mêmes « leur mot sur leurs propres affaires » pour citer l’éminent auteur Carré de Malberg, en 1931… La France est un pays de délégation intégrale, voire confiscatoire, du pouvoir aux gouvernants et, par suite, de démocratie intermittente. En fait, on enferme le citoyen dans le rôle d’électeur, si bien que le reste du temps, il n’est que spectateur du déroulement de l’action politique. Quand un sujet important survient, il ne reste guère que la rue pour l’expression populaire, comme on l’a vu avec le mariage pour tous, puis les Gilets jaunes et maintenant les retraites.
Ce fonctionnement discutable au regard de l’idéal démocratique résulte de la marginalisation des citoyens dans la direction du pays. Tout est aux mains du complexe politico-administratif central, lequel estime détenir le monopole de l’expertise. C’est lui seul qui pense et qui sait. La soupape qui pourrait être mise en place pour apporter une respiration à ce système fermé est connue : le référendum d’initiative citoyenne (RIC). Sur la base d’une pétition émanant d’une fraction de la population une consultation a lieu pour trancher la question portée dans ce cadre.
Le RIC correspond à une attente réelle dans la population. Mais, c’est aussi une arlésienne : on en parle au moment de la présidentielle et puis le sujet disparaît des radars. Nombre d’élus, quant à eux, ne dissimulent pas leur scepticisme quant à sa justification, si bien qu’il n’y a pas, à l’heure actuelle de majorité, dans les chambres pour introduire le RIC dans la Constitution. La classe politique française est clairement mal à l’aise avec la démocratie directe.
La messe est-elle dite pour autant ? Non, car la Constitution comporte un plan B : la voie directe de l’article 11, empruntée déjà en 1962 s’agissant de l’élection du Chef de l’Etat au suffrage universel, et validée par le Conseil constitutionnel avec la décision dite « Monnerville » . Cette voie mérite la qualification de directe parce qu’elle se résume au dépôt par l’exécutif d’un projet de loi qui est soumis sans filtre au corps électoral et approuvé ou non par celui-ci Dans son traité de doit constitutionnel[1], le Pr Gohin confirme la constitutionnalité de cette voie de révision toujours contestée en doctrine – considérant après une confrontation minutieuse des « pour » et des « contre » qu’en sa qualité d’autorité titulaire de la souveraineté « le peuple reste en mesure quant à lui de briser le cercle de la Constitution imposée » (p. 693).
Subsiste un ultime obstacle : le déclenchement d’une consultation référendaire demeure captif de la volonté présidentielle. Il est raisonnable d’estimer que le Président ne pourrait pas s’opposer durablement, sauf à risquer la crise de régime comme Charles X en 1830, à une demande correspondant à une attente forte largement partagée dans l’opinion.
Techniquement, la loi de révision comporterait, selon nous, approbation d’un alinéa dédié au RIC qui viendrait compléter l’article 3 de la Constitution, les modalités du référendum déjà prévues à l’article 11 actuel devenant subsidiaires. Le champ du référendum serait, bien entendu, étendu à l’ensemble du spectre formant la matière de l’action gouvernementale. Le contrôle citoyen en continu de l’action des gouvernants deviendrait effectif. C’est ce que l’on doit retenir de la pratique courante des « votations » en Suisse. Initiées par les citoyens, le Pr F. Garçon n’hésite pas, dans son ouvrage de synthèse sur ce pays[2], à considérer que le regard vigilant porté par les gens sur le travail des élus , permis par ces consultations semblables au RIC , est l’une des raisons de la prospérité de la Suisse
C’est désormais cette tension vers la modernité – ce grand bond républicain – qu’il incombe à la démocratie française d’accomplir pour mette fin à son encalminage dans le tintamarre des manifestations surannées et de la gréviculture dispendieuse.
A noter que les conventions citoyennes lancées par le pouvoir macronien pour sortir de l’impasse ne sauraient faire office de substitut au RIC. Elles ne sont que des instances de propositions et leur composition issue en majorité d’associations militantes n’est pas représentative des Français.
Bernard Brenet
[1] Olivier Gohin , Droit Constitutionnel , Lexis Nexis , 2022 , p . 693.
[2] François Garçon , Le Génie des Suisses, Tallandier , 1918 , p . 312.












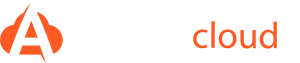
Laisser un commentaire