En finir avec la gréviculture
Ces dernières années, un rituel semble s’être établi à la SNCF : des menaces de grève dès que se profilent les départs en vacances ou des fériés.
Cette année, ce sont les départs en week-end de début mai qui sont visés. Le motif, cette fois, c’est la rémunération insuffisante des contrôleurs. Et demain, ce sera quoi ? C’est un chantage sans fin, avec à la clé des chèques réglés par le contribuable et une hausse constante du prix des billets.
Les agents de la SNCF, gavés d’avantages sociaux par ailleurs, ne se situent pas dans le peloton de queue des rémunérations, loin s’en faut. Ils jouissent par ailleurs d’un bien très précieux dans le contexte actuel : la sécurité de l’emploi, alors que l’économie bafouille et que beaucoup de Français se retrouvent au chômage.
Si la SNCF est bien une entreprise privée très fortement endettée, elle est en charge d’une mission de service public d’intérêt national et, à ce titre, épaulée par l’État, c’est-à-dire les contribuables. C’est assez dire que ses agents doivent intégrer qu’ils ont à fournir à la collectivité les services qu’elle en attend, à savoir, assurer une circulation normale des trains. C’est ce qu’on appelle la continuité du service public. Cette exigence ne saurait rester un objectif modulable selon les humeurs des personnels, et spécialement des responsables syndicaux, lesquels se sont, depuis toujours signalés par un vif activisme catégoriel reposant sur une interprétation du droit de grève tendant à sa déification.
Le problème est aussi ancien que les grèves qui ont, depuis des décennies, rythmé la vie de certains services publics en France, occasionnant une gêne souvent considérable aux usagers. Dès que l’on aborde ces questions, les syndicats se cabrent et dégainent le joker : respect absolu du droit de grève !
C’est abuser l’opinion. En droit, cette lecture des choses n’est pas recevable. En regard du droit de grève il y a, dans notre hiérarchie des normes, un principe pesant aussi lourd, celui de la continuité du service public. C’est ce qu’a rappelé le Conseil d’État dans un arrêt de principe de 1950 (Dehaene). Il ressort de cette décision que le droit de grève n’est pas un droit absolu. Il peut dès lors être réglementé afin d’obvier à un usage abusif, et ce, à l’effet que s’instaure sa conciliation nécessaire avec la sauvegarde de l’intérêt général. Rien que du bon sens. C’est ainsi qu’à différentes reprises, des grèves dans le service public ont été déclarées illégales et assorties de sanctions disciplinaires à l’encontre de leurs auteurs. Au fil du temps, une jurisprudence concernant toutes les catégories de services publics s’est construite sur un savant équilibre entre les deux principes en apparence contradictoires rappelés ci-dessus.
Mais quand même, dans l’ensemble à l’avantage du droit de grève. C’est cette anomalie qu’il faut corriger !
Face à la lassitude des usagers, en 2007, sous Sarkozy, une loi a, dans les transports, posé le principe d’un service minimum. Néanmoins, les grèves ont persisté car le dispositif mis en place est insuffisamment contraignant. Il convient, dès lors, de passer à un stade supérieur : l’interdiction pure et simple de la grève dans les hypothèses où l’intérêt général doit impérativement être sauvegardé. Cette mesure forte ne constituerait nullement une négation du droit de grève, comme glapissent les syndicats de cheminots, mais marquerait plutôt le passage à un stade supérieur de régulation dicté par la nécessité d’un bon accomplissement du service public.
L’Italie fournit à cet égard un modèle avec la prohibition séquencée de la grève, en l’excluant pendant les périodes de vacances scolaires. et fêtes marquantes. Transposée en France, cette mesure permettrait d’obturer les trous dans la raquette qui subsistent en matière de régulation des grèves dans les transports, de sorte qu’enfin, il soit mis un terme à l’inconfort des usagers que provoquent ces dysfonctionnements intempestifs du service public. C’est Raymond Barre qui, dans les années 70, stigmatisait les nantis. On voit très bien de qui il s’agissait. Paul Morand déplorait déjà, voici un siècle, que les Français ne mesurassent pas qu’ils vivaient dans un palais, et que cela pourrait ne pas durer s’ils persistaient dans leurs égarements.






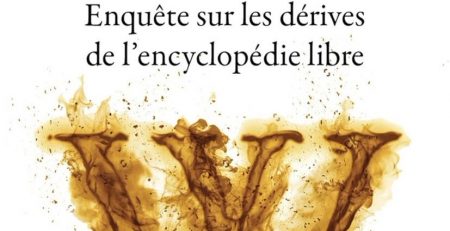

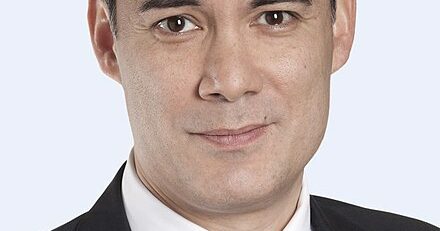


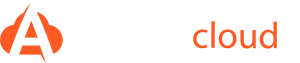
Laisser un commentaire