L’Union européenne à la croisée des chemins
Force est de constater que le bilan de l’Union européenne suscite bien des interrogations. Tandis que la Russie dotée d’immenses ressources naturelles, notamment énergétiques, n’a jamais manifesté la volonté d’intégrer l’UE, certains membres historiques, comme le Royaume Uni, ont choisi le départ en grande partie pour reprendre le contrôle de leur politique migratoire.
Problèmes migratoires et cohésion européenne
La politique migratoire de l’UE s’est progressivement durcie face à la pression migratoire aux frontières sud et est du continent révélant les limites du dispositif de Schengen et l’incapacité chronique des États membres à harmoniser leurs approches. Les flux persistants de migrants accentués par les crises au Moyen Orient et en Afrique ont alimenté tensions sociales, inquiétudes identitaires et débats sur la capacité d’intégration des sociétés européennes. Les réponses apportées oscillant entre accords bilatéraux et renforcement des contrôles, peinent à endiguer durablement les arrivées, ce qui accentue la défiance envers les institutions européennes.
Dépendance énergétique et choix stratégiques
L’Europe s’est également retrouvée fragilisée par sa dépendance aux importations énergétiques en particulier vis-à-vis de la Russie pour le gaz et le pétrole. Cette situation est le fruit de choix stratégiques qui n’ont pas suffisamment anticipé les risques géopolitiques et les aléas du marché mondial. L’arrêt de projets majeurs dans le nucléaire- tels les réacteurs à neutrons rapides ou le développement du retraitement- a forcé le recours accru aux énergies fossiles passant à côté d’options technologiques qui auraient renforcé l’autonomie du continent.
Intégration russe, occasion manquée ou utopie ?
Au fil des décennies, de nombreuses voix ont plaidé pour un rapprochement stratégique avec la Russie, arguant de proximités, historiques, culturelles et économiques. L’intégration de la Russie à l’UE aurait permis de bâtir un vaste ensemble cohérent de l’Atlantique au Pacifique, renforçant la sécurité énergétique, et redéfinissant la position européenne face aux puissances émergentes asiatiques. Mais les divergences de visions – démocratie pluralistes pour l’UE, affirmation de puissance pour la Russie – et le contexte conflictuel ont rendu ce projet de plus en plus improbable.
Pour une refondation lucide et pragmatique
La construction européenne ne saurait s’en remettre à de simples slogans. Elle impose des choix stratégiques forts : retrouver une certaine indépendance énergétique, adapter la gestion des flux migratoires dans le respect des valeurs européennes et repenser les alliances continentales à l’aune d’un nouveau contexte mondial. L’échec à intégrer la Russie et la persistante dépendance aux ressources extérieures illustrent la nécessité d’une approche pragmatique et solidaire pour surmonter les divisions, renforcer la sécurité et regagner la confiance des citoyens.
Analyse critique de la position française
À la lumière des développements récents, la situation de la France au sein de l’Union européenne mérite une attention particulière. La France apparaît aujourd’hui comme l’homme malade de l’Europe. Son positionnement migratoire très ouvert, qu’elle partage avec la Belgique francophone, contraste avec la prudence d’autres États membres. Cette orientation conjuguée à une certaine russophobie et à une américanophobie institutionnelles, a pour effet de détourner des marchés à l’est tout en exposant l’Europe à de nouvelles taxes et pressions à l’ouest avec des conséquences économiques directes: la Russie privilégie désormais les fournisseurs chinois, n’achète plus massivement européen (automobiles, agroalimentaire, etc.) et l’Ukraine, historiquement dépendante du soutien russe, se tourne vers l’Europe surtout comme bénéficiaire, provoquant un afflux de réfugiés et une demande d’assistance militaire sans réelle contrepartie économique.
Sur le plan international, ces dynamiques accroissent la dépendance énergétique et industrielle vis-à-vis de la Chine, en passe de s’affirmer comme la première puissance mondiale, “l’usine du monde”, en grande partie grâce à son partenariat stratégique avec la Russie. Mais l’exemple le plus préoccupant reste domestique : la France fait figure de mauvais élève au sein de l’UE, cumulant désordre social, émeutes, et instabilité politique. Son endettement public, fait peser des risques sur la stabilité de la zone euro, comme la Banque Centrale Européenne ne cesse de le rappeler.
Des questions structurelles persistent, notamment la viabilité du système de retraites, frappé d’obsolescence. Le financement des pensions des fonctionnaires – alimentant d’abord le budget général de l’État avant d’être redistribuées – reflète à la fois une spécificité du modèle français et une faiblesse comparée à la plupart des États européens, qui privilégient des systèmes mixtes ou plus capitalisés reposant sur la durée effective de cotisation, souvent jusqu’à 67 ans. Malgré ses imperfections, l’administration européenne joue un rôle d’unification et de stabilisation, même si elle donne parfois l’impression de retenir les normes des pays les plus stricts.
L’Union européenne demeure ainsi à la croisée des chemins : son évolution dépendra de la capacité des États membres et en particulier de la France à réformer leurs institutions, à restaurer la confiance interne, et à définir enfin au-delà des tensions géopolitiques une stratégie économique et sociale cohérente.












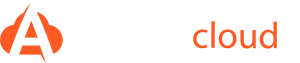
Comments (1)
L’ Union Européenne par sa Commission ” choisie ” est résolument nulle part !
Elle n’ est donc pas à une ” croisée de chemins ” ( lesquels sont sans doute supérieurs à deux )
Les intérêts des Etats Membre de l’ Union sont sans conteste bien plus divergents que les ” positions ” politiques de la C.D.U / C.S.U. et celles du Parti Social Démocrate Allemand qui arrivent après d’ âpres tractations à bâtir une ” KOALITION ” dont le seul intérêt consiste à ce que ces deux Partis CONSERVENT À VIE LE POUVOIR … EN ALTERNANCE en conduisant à peu près LA MÊME POLITIQUE ( économique, culturelle, migratoire, extérieure etc … )
Bref c’ est la politique de ” l’ eau tiède ” menée contre des Pays ” bouillants ” ( Chine, Inde, Russie , Iran, Indonésie etc, etc … )
Diogène une lanterne à la main parcourait agité une lanterne à la main et en plein jour les rues, les places, les marchés, les temples, les académies, les gymnases d’ Athènes … Quelqu’ un lui demanda ce qu’ il cherchait ; ” JE CHERCHE UN HOMME ” répondit il !
Hé bien nous aussi nous cherchons aussi un homme mais certainement pas un Emmanuel Macron ou une femme mais certainement pas une Ursula von Der Leyen qui s’ est une fois de plus ridiculisée en affirmant que : ” l’ Europe défendra chaque cm² de son territoire ” alors qu’ elle n’ est pas même en capacité d’ en défendre efficacement 1 cm²
La comédie devient burlesque