Mensonges budgétaires et fausses économies
François Bayrou, après tant de ses prédécesseurs à Matignon, se lance à son tour dans le numéro budgétaire qui n’en finit plus de lasser les Français.
Comme ses prédécesseurs, il nous promet une restauration des finances publiques sans hausse d’impôts mais avec une hausse des investissements (la petite nouveauté étant que les investissements en question sont militaires au lieu d’être une énième version du traditionnel « Demain on rase gratis » de la gauche qui règne sans partage sur les assemblées parlementaires).
Aussitôt, le jeu de rôles se met en place : les oppositions, de gauche comme de droite, menacent de censurer le gouvernement si, d’aventure, le pouvoir d’achat des Français diminuait.
Mais oppositions et majorité agissent comme si tout avait été tenté sans succès pour limiter la dépense publique et comme si, entre gens sérieux, les arrangements ne pouvaient se faire qu’à la marge : on veut bien discuter d’augmenter ou de réduire la TVA ou le RSA d’un point, mais ici s’arrête la marge de négociation.
Il est pourtant trop évident que ce n’est pas ainsi que l’on pourra restaurer les finances publiques.
La première chose à faire est de cesser de prétendre que lorsque l’on diminue le service public, on fait des économies. Si la qualité du service public diminue sans diminution des impôts, ce n’est rien d’autre que le rétablissement de la corvée.
Au passage, je suis frappé du nombre de maux que l’on reproche – souvent à juste titre – à l’Ancien Régime et qui sont pourtant aussi présents sous Marianne V que sous Louis XVI.
Nous avons donc restauré la corvée (qu’est donc le lundi de Pentecôte travaillé mais non payé, sinon un jour de corvée ?), le gouvernement des juges, le corporatisme dans la plupart des domaines économiques et sociaux, et même les fermiers généraux (puisque, désormais, à Paris, ce sont des sociétés privées qui rackettent les automobilistes en usant de la puissance publique pour émettre des amendes).
Mais revenons aux finances publiques. Le deuxième impératif est de ne pas laisser croire que le déficit public s’impose aux gouvernements qui n’y peuvent rien : la réalité est que le déficit est un choix politique.
Car personne n’oblige le gouvernement à faire voter des budgets dans lesquels les dépenses excèdent les recettes.
Enfin, le vote d’un budget est le cœur de l’action politique : c’est là qu’il est le plus clair que gouverner, c’est choisir.
Aucune économie ne sera possible si nos gouvernants continuent à considérer que le budget sert d’abord le clientélisme.
Nous attendons d’eux qu’ils nous disent quelles priorités ils choisissent et pourquoi, pas qu’ils nous jouent sempiternellement le même jeu grotesque et lassant.
Le bon sens imposerait que l’on considère que les citoyens sont, pour l’État, prioritaires sur les étrangers. Dans les circonstances actuelles, il semblerait également raisonnable de dire que les dépenses militaires sont prioritaires sur les dépenses sociales.
Mais non, « on » continue de faire comme si l’État avait le devoir de nourrir la planète entière et les va t’en guerre les plus excités sont aussi ceux qui réclament que le SMIC soit augmenté et refusent que le RSA s’accompagne d’une obligation de travailler.
Il reste pourtant une option inexplorée : celle de la responsabilité. Ne prenons qu’un exemple : créez le chèque scolaire et vous réaliserez des milliards d’économies sur la gabegie de la prétendue Éducation nationale, tout en augmentant le niveau. Mais c’est précisément là que le bât blesse : nos politicards veulent bien faire semblant de faire des économies, ils ne sont pas prêts à abandonner le pouvoir que nous leur avons abandonné !











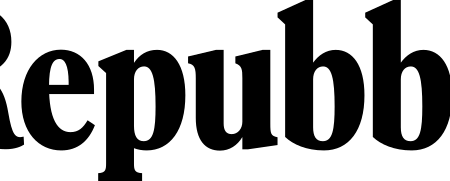
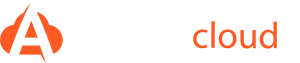
Laisser un commentaire