Nouvelle-Calédonie : rester présents dans le Pacifique
De l’époque coloniale la France a hérité de territoires – Polynésie, Réunion, Nouvelle-Calédonie, îles Kerguelen, Mayotte – qui lui assurent une envergure planétaire. Compte tenu du déplacement du centre de gravité du monde de la zone atlantique à la vaste zone indo-pacifique, ces possessions et le domaine maritime attaché permettent à notre pays de demeurer un État qui compte dans le concert mondial.
Notre horizon n’est, de ce fait, pas borné à l’hexagone. Nous restons au contact des mouvements du monde. Là où, en ce siècle, se joue son avenir.
En mai 2024, en Nouvelle-Calédonie, une insurrection déclenchée par les Canaques, non anticipée par les autorités – alors que prévisible –, suite à la décision de « dégel » du corps électoral prise par le gouvernement, a traduit la remise en cause, par les autochtones, de notre souveraineté sur ce territoire.
Dans le but de provoquer un mouvement de panique dans la communauté d’origine française, les insurgés ont saccagé méthodiquement la zone industrielle de Nouméa, poumon économique de l’île. Cette gigantesque casse, d’une stupidité sans nom, mais répondant à un objectif politique clair, s’est accompagnée d’un discours menaçant envers les « Blancs ». Courageusement, les loyalistes ont fait face et entendent reconstruire l’économie du pays. Les « Caldoches » sont chez eux à Nouméa, comme les pieds-noirs étaient chez eux à Alger.
À cela s’ajoute que, vu sa position, la Nouvelle-Calédonie est le barycentre de notre présence dans le Pacifique. Elle se trouve en effet au cœur de l’arc indo-pacifique formé par les territoires cités au début. Il est dès lors dans l’ordre des choses qu’elle demeure sous souveraineté française.
En application des accords dits de Matignon signés par Rocard, puis Jospin, des consultations ont été, au fil du temps, organisées aux fins de vérifier les attentes de la population locale. Les trois référendums organisés successivement ont dégagé à chaque fois une majorité en faveur du maintien de l’archipel dans la République. Il n’y a dès lors plus de sujet à cet égard. Mais pas pour tout le monde.
En mai dernier, le ministre des Outre-Mer, décolonial rocardien avéré, n’avait rien trouvé de mieux que d’offrir aux Canaques séparatistes l’indépendance de l’île sur un plateau avec son projet biscornu « d’association avec la France » et non pas dans la France ! La fin de non-recevoir vigoureuse opposée à cette perspective par les loyalistes a conduit le chef de l’État à réagir.
À son initiative, début juillet, un sommet entre indépendantistes et loyalistes s’est tenu en banlieue parisienne.
De manière inattendue, un accord est intervenu au matin du 12 juillet. Il prévoit la reconnaissance d’un État calédonien au sein de la République française. Il s’agit là d’une novation en discordance avec notre conception unitaire de l’État, mais de nature à satisfaire une des revendications phares des Canaques. Est-ce une manière déguisée d’accorder l’indépendance à la Nouvelle-Calédonie ?
D’après le texte de l’accord, l’exercice des pouvoirs régaliens (sécurité, défense, justice, monnaie) demeure l’attribut de la métropole, avec toutefois l’idée d’une association progressive des autorités calédoniennes. La communauté française a dès lors la garantie d’être, si besoin, protégée par la France et de pouvoir économiquement relancer ses affaires. Il reste qu’est créée une nationalité calédonienne, donc une citoyenneté distincte de la citoyenneté française, et que la nouvelle entité pourra être reconnue à l’international et disposera d’une très large autonomie dans la conduite de ses relations extérieures. Ces concessions faites aux indépendantistes tangentent à l’indépendance effective. On verra à l’avenir comment les choses évolueront. Un glissement vers l’indépendance ne peut être écarté.
La France jouait gros. Si nous n’avions pas écarté l’idée d’indépendance de l’archipel, un très mauvais signal aurait été délivré. Il aurait fallu craindre, par effet de domino, qu’un vent de contestation de notre présence ne se lève dans nos autres territoires du Pacifique de même qu’en Guyane.
Dans l’immédiat, notre pays paraît avoir préservé l’essentiel : demeurer chez lui en Nouvelle-Calédonie. Nous avons avec notre présence historique dans le Pacifique une fenêtre ouverte sur le monde qui vient. Il était impératif de conserver cet acquis. Mais, à l’évidence, il faudra être attentif à la cohérence des choix des autorités calédoniennes avec ceux de la métropole.




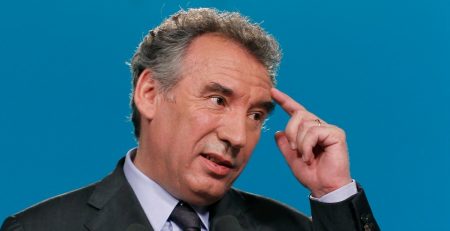





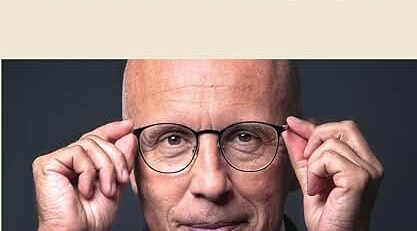

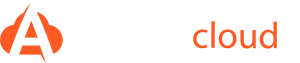
Laisser un commentaire