Pour la rétention de sûreté sans modération
Le crime commis au pont de Bir-Hakeim par un islamiste iranien élevé en France dès son plus jeune âge nous rappelle, telle une violente gifle, que, côté terrorisme, rien n’est réglé malgré le renforcement constant des moyens en matière de renseignement et les attentats déjoués.
Les commentateurs de ce drame n’ont pas manqué de poser la question qui fâche : que faisait en liberté cet élément radicalisé fiché S ? Il avait purgé sa peine de 4 ans d’emprisonnement prononcée en 2016 pour projet d’attentat, rétorquent les autorités, pas très à l’aise après ce nouveau fiasco.
Pourtant, un rapport relatif au comportement de l’intéressé en détention indique qu’il avait fait montre d’un état d’esprit augurant du pire à sa sortie. Cette dangerosité intacte s’est pleinement libérée le 2 décembre avec le lâche assassinat que l’on sait.
C’est assez dire la vigilance dont il faut faire preuve face à ces fanatiques et l’implacabilité qui doit caractériser leur sanction par la justice. Mais est-ce le cas ?
Cet attentat interroge sur la durée des peines prononcées à l’encontre de ces terroristes. Est-elle suffisante ? C’est une idée pernicieuse que la recherche pathétique de l’humanisation de la justice pénale.
Dans cette logique, sauf exception, les tribunaux répugnent à appliquer la loi dans toute sa rigueur, même en matière de terrorisme. Il est considéré que 4 ans de détention sont déjà une lourde peine face à des gens, pour certains incurables.
Quand il apparaît, à l’issue de la détention, que le détenu est resté un sujet à problème, que fait-on ? L’attentat en question vient d’infliger un démenti cinglant aux bonnes âmes adeptes des peines mesurées et de la réinsertion obligée.
La rétention de sûreté, procédé de maintien en détention après l’exécution de la peine, apparaît une précaution indispensable pour garantir la sécurité face à ces individus susceptibles de récidive. Le cadre juridique existe avec la loi du 30 juillet 2021 relative au suivi socio-judiciaire.
Reste à mieux l’adapter à la problématique terroriste. Au moins, un signal fort serait émis à l’adresse des terroristes. La perspective d’enfermement reconductible ne découragera pas les enragés de l’islam belliqueux, mais les tièdes probablement.
Comme il est de règle, on nous annonce que la CEDH ou le Conseil constitutionnel pourraient s’en mêler. Il n’est pas besoin d’espérer pour entreprendre … Le principe de réalité doit s’imposer face aux ratiocineurs qui tenteraient de s’opposer à cette mesure de bon sens.
La rétention de sûreté n’est pas la seule mesure à envisager pour se prémunir contre les loups solitaires qui peuvent frapper à tout moment. Ces crimes récurrents combinent deux motifs : imposer la religion d’Allah, mais aussi sidérer les mécréants. Ce sont des crimes racistes qui tangentent aussi au génocidaire lorsqu’ils visent plusieurs centaines de personnes comme au Bataclan ou à Nice.
Il convient, dès lors, de prendre toute la mesure du danger. Les autorités sont démunies face aux tueurs qui se glissent dans le flot des migrants. En revanche, elles peuvent peser sur la population des agresseurs potentiels identifiés sur le territoire, à savoir les fichés S, et prendre en amont les mesures de coercition appropriées.
Encore une fois, l’internement préventif de ces fichés S ne garantirait pas contre toute attaque, mais il neutraliserait les tentés de passer à l’acte.
Cette mesure aurait en outre la vertu d’effacer l’image de peuple assiégé que diffusent les musulmans à notre endroit. Il faut clairement créer sans retard des camps d’internement (10 ans sont nécessaires pour construire une prison !) gardés par l’armée pour isoler ces individus. Rompus au maniement des armes, et ayant le mental idoine, des militaires seront plus aptes que des personnels pénitentiaires à parer aux tentatives d’évasion.
Ces propositions pourraient se heurter aux glapissements ordinaires des défenseurs de l’État de droit. C’est même probable. Sauf que l’État de droit dont nous parlent ces apôtres est fantasmé : ce n’est pas celui confronté au réel décrit par la jurisprudence du Conseil d’État relative aux circonstances exceptionnelles, ni celui des pouvoirs de crise inscrits dans le Constitution.
L’État de droit n’est pas qu’une abstraction, c’est un cadre dont le format peut varier en fonction des nécessités du présent. C’est un cadre ajustable qui fait que les autorités peuvent, sans commettre d’irrégularités, prendre des mesures qui, dans un autre contexte, auraient été considérées comme illégales.





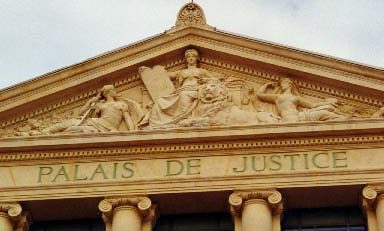






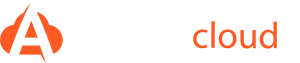
Laisser un commentaire