Pour un regard dépassionné sur la peine de mort
Périodiquement, le sujet revient dans l’actualité. Les sondages révèlent qu’aux alentours de 50 % de nos compatriotes demeurent favorables au prononcé de cette peine abolie en octobre 1981, contre le sentiment dominant dans l’opinion.
Mais la classe politique avait, à l’époque, fait, de cette suppression le symbole de temps nouveaux intégrant l’humanisation de la justice.
Considérée comme un châtiment barbare, la peine de mort a été estimée contraire à l’État de droit, ce qui interdit, selon ses adversaires, d’en envisager le rétablissement.
Il y a, selon nous, au moins deux manières d’aborder cette problématique : la dramatisation germanopratine telle qu’orchestrée dans les années 70 par les abolitionnistes (exécuter un condamné était, pour leur chef de file, Maître Badinter, « ajouter un crime au crime »), ou préférer une approche adossée à la considération qu’un crime est une forme d’abus du droit. Cet abus consistant à priver une personne, parfois par sottise (plantage pour une cigarette refusée) , de son bien le plus cher : la vie.
Cette vision technique conduit à se demander, avec raison, si celui qui prend délibérément la vie d’un autre ne perd pas, par ce fait même, son propre droit à la vie.
L’exécution consécutive de l’intéressé apparaît, dès lors, sous cet angle, non plus comme une hyper-violence de la société, mais comme une façon d’acter l’épuisement du droit du coupable à lui appartenir. Au fond, rien de dramatique ni d’indigne à l’effacement de cette vie, lequel s’analyse en une issue normale à la rupture du contrat moral qui lie chacun d’entre nous à la société, scellé par le biblique « tu ne tueras point ».
Telle est selon nous l’équation d’un éventuel retour de ce châtiment, dès lors que, comme l’on sait, il n’y a pas d’immutabilité du droit. Seule réserve, non dirimante toutefois, la succession de haies à franchir : d’une part, révision de la Constitution et, d’autre part, dénonciation des stipulations qui, dans les traités ou les conventions signées par la France, prohibent la peine de mort.
La France connaît une criminalité alarmante, en volume ainsi que par son caractère multiforme (féminicides courants, viols de femmes, cambriolages meurtriers, attentats terroristes récurrents, etc. ). Elle est entrée en décivilisation. Il suit de là que, dans le registre des peines, il faut sans doute réintroduire un signal fort à l’adresse de tous ceux pour qui le respect d’autrui ne revêt pas le caractère d’un impératif évident. Pour illustration : le viol odieux commis à Cherbourg, au cours de l’été 2023, sur la personne d’une femme de 29 ans. L’auteur de l’agression, entré par effraction au domicile de la victime, n’a rien trouvé de mieux que d’accompagner son forfait de sévices ayant occasionné à la malheureuse des lésions possiblement irréparables. Une destruction, physique, un quasi-meurtre ! Voilà l’exemple même d’affaire qui invite à réfléchir à une réponse pénale signifiante. Serait-ce le coup de talon sur le fond de la piscine de nature à permettre à notre pays de se ressaisir et, par là, se reconnecter à sa vocation : rester une société vivable ? On doit l’espérer.



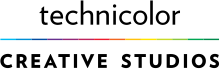






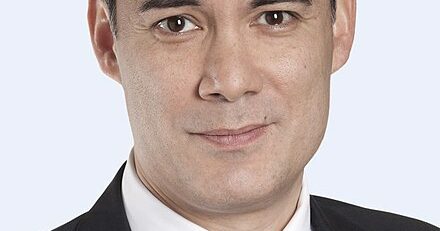

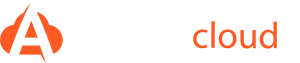
Laisser un commentaire