Quand la France sert du Starbucks avec un accent McDonald’s
Dans le hall 2C de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, je me tiens, valise à la main, prêt à m’envoler pour le Canada. L’estomac gargouille, l’âme réclame un café – pas n’importe lequel, un vrai café, celui qui sent le grain torréfié, la tradition française, l’élégance d’une tasse posée sur une table en bois patiné. Mais ici, dans ce temple de la modernité aéroportuaire, le choix est aussi limité qu’un menu de fast-food : McDonald’s ou Starbucks. Deux géants américains, deux empires du standardisé, qui me regardent avec leurs enseignes clinquantes. Où sont passés nos bistrots, nos torréfacteurs indépendants, nos artisans du café ? Pourquoi, dans le premier aéroport de France, la patrie de Voltaire et de l’espresso serré, ne puis-je pas siroter un café digne de ce nom ? La réponse, mes amis, est aussi amère que le breuvage de Starbucks : le système des appels d’offres et les conditions d’accès au marché aéroportuaire.
Le grand Monopoly des multinationales
L’aéroport de Roissy-CDG, géré par le groupe ADP (Aéroports de Paris), est une machine bien huilée où chaque mètre carré est monétisé comme un lingot d’or. Les espaces commerciaux, y compris les cafés, sont attribués via des appels d’offres rigoureux, des compétitions où les petits joueurs sont vite balayés. Ces appels d’offres, comme ceux publiés sur des plateformes comme marchesonline.com, exigent des candidats une solidité financière à toute épreuve, une expérience internationale, et une capacité à générer un chiffre d’affaires colossal. Traduction : si vous n’avez pas un siège social à Seattle ou un logo mondialement reconnu, passez votre chemin.
Les multinationales comme Starbucks et McDonald’s, avec leurs armées de juristes et leurs bilans comptables plus épais qu’un roman de Proust, raflent la mise. Elles peuvent s’engager sur des loyers exorbitants – souvent plusieurs dizaines de milliers d’euros par mois pour un emplacement stratégique – et garantir un flux constant de clients grâce à leur notoriété. Un torréfacteur indépendant de Belleville, aussi talentueux soit-il, n’a ni les reins assez solides ni les moyens logistiques pour rivaliser. Pire, les critères des appels d’offres favorisent les enseignes capables d’opérer à grande échelle, avec des « supply chains » rodées et une uniformité qui rassure les gestionnaires d’aéroports. Résultat : le voyageur, qu’il vienne de Tokyo ou de Toulouse, se retrouve à commander un « latte » standardisé dans un gobelet en carton, pendant que la culture française du café reste bloquée au contrôle de sécurité.
Mais ce n’est pas tout. Les conditions d’accès imposent aussi des normes draconiennes : certifications sanitaires, capacités à gérer des volumes élevés, horaires d’ouverture 24/7, et même des exigences esthétiques pour coller au « standing » de l’aéroport. Un petit café de quartier, avec son comptoir en zinc et son patron moustachu, n’a aucune chance face à ces Goliath du capitalisme. Comme le disait un voyageur excédé sur X : « On est vraiment dans un pays de fous » où Starbucks prospère pendant que les commerces de proximité sont laissés sur le tarmac.
Une colonie américaine en sol français ?
Roissy-CDG, avec ses 70 millions de passagers annuels, est la vitrine de la France. C’est ici que le monde pose son premier regard sur notre pays, et que voit-il ? Des burgers, des frappuccinos, et des files d’attente où l’on parle anglais par réflexe. La gastronomie française, pourtant vantée par Air France avec ses chefs étoilés à bord, semble reléguée aux oubliettes dès qu’on foule le sol de l’aéroport. On dirait une colonie américaine, où la bannière étoilée flotte plus haut que le drapeau tricolore.
Cette domination des multinationales n’est pas une fatalité, mais le fruit d’un choix. ADP, en quête de profits maximums, préfère la sécurité des grandes enseignes aux risques d’une offre locale. Starbucks et McDonald’s, avec leurs « food courts » rutilants comme celui du terminal 1, garantissent des revenus stables et une image « internationale ». Mais à quel prix ? Celui de l’âme française, écrasée sous le poids des gobelets en carton et des nuggets surgelés.
Une solution légale pour un café bien de chez nous
Alors, comment redonner à Roissy une touche d’élégance française, un soupçon de terroir, sans tomber dans l’illégalité ou la nostalgie béate ? La réponse tient en trois mots : réformer les appels d’offres. Voici une feuille de route pour que nos torréfacteurs indépendants puissent poser leurs cafetières à Roissy sans vendre leur âme au diable.
Assouplir les critères financiers : ADP pourrait réserver une partie des espaces commerciaux à des PME françaises, avec des loyers plafonnés et des garanties financières moins écrasantes. Un modèle inspiré des marchés portugais, où les partenariats locaux sont encouragés, pourrait fonctionner. Par exemple, un collectif de torréfacteurs parisiens pourrait mutualiser ses ressources pour répondre à un appel d’offres.
Valoriser le patrimoine culturel : Les appels d’offres pourraient inclure un critère de « valeur culturelle », primant les enseignes qui mettent en avant la gastronomie française. Un café proposant des grains de petits producteurs, des pâtisseries locales, et une ambiance de bistrot aurait plus de chances de séduire les voyageurs en quête d’authenticité qu’un énième Starbucks.
Créer des espaces dédiés aux artisans : Imaginez un « village gastronomique » dans le hall 2C, où des torréfacteurs indépendants, des pâtissiers, et des fromagers locaux auraient des stands. Ce concept, déjà testé dans certains aéroports comme celui de Lisbonne, permettrait de contourner les exigences de volume tout en offrant une vitrine aux artisans français.
Subventions et partenariats publics : Les régions Île-de-France et Val-d’Oise, qui soutiennent déjà l’économie locale via des initiatives comme le CEEVO, pourraient subventionner l’installation de commerces indépendants à Roissy. Des partenariats avec des écoles hôtelières pourraient aussi former des baristas capables de rivaliser avec les standards internationaux.
Légalement, rien n’empêche ADP de modifier ses appels d’offres pour favoriser les acteurs locaux. La réglementation européenne, qui encadre le secteur aéroportuaire, laisse une marge de manœuvre pour promouvoir la diversité culturelle et économique. Il suffit d’un peu de volonté politique et d’une pincée de fierté nationale.
La France, plus qu’un gobelet en carton
Redonner à Roissy son identité française, c’est refuser de n’être qu’une escale standardisée dans le grand Monopoly mondial. C’est offrir au voyageur, qu’il parte pour le Canada ou Katmandou, un café qui raconte une histoire : celle d’un torréfacteur de Montmartre, d’un grain cultivé avec soin, d’une France qui ne plie pas devant les sirènes du profit. Car, soyons honnêtes, un pays qui sert du Starbucks à ses visiteurs a déjà perdu une bataille culturelle.
Alors, messieurs-dames d’ADP, rangez vos tableurs Excel et écoutez le cœur de la France. Laissez nos artisans prendre leur envol dans les halls de Roissy. Et à vous, voyageur pressé du hall 2C, la prochaine fois que vous commanderez un café, demandez-vous : voulez-vous un « latte » sans âme ou un espresso qui chante la Marseillaise ? La réponse, comme le café, doit être corsée.
Vive la France, vive le café, et à bas les gobelets en carton !





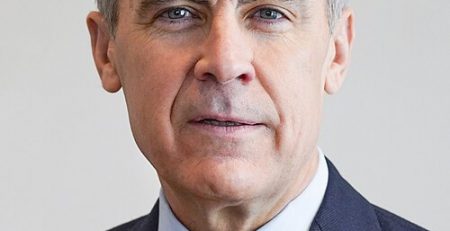


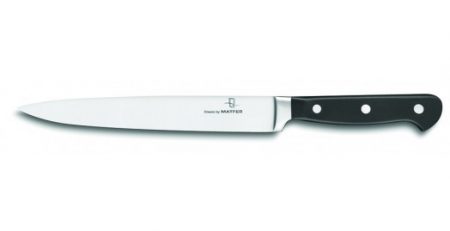
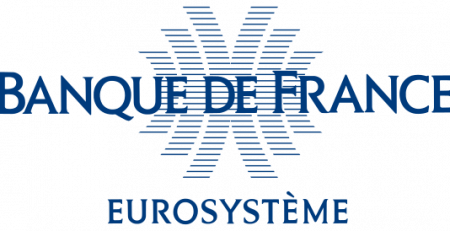

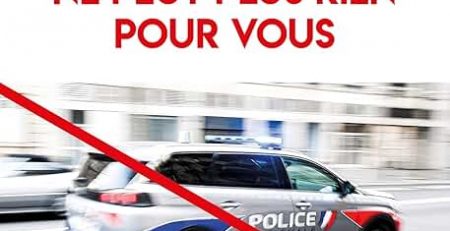
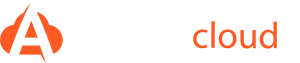
Laisser un commentaire