Quand la politique devient un bon métier…
Redresser une entreprise « en difficulté » nécessite non seulement du courage, une vision claire, mais aussi un fort renouvellement des équipes et de leur direction. Comme aurait dit Albert Einstein, on ne résout pas un problème avec la manière de penser qui l’a créé.
Or, s’agissant de la situation de notre pays, en tout cas depuis le début de la Ve République en 1958, on est frappé de constater que nos dirigeants, de droite comme de gauche, semblent avoir été formatés selon un moule unique, de plus en plus étroit. Non seulement au niveau de l’État, mais aussi à celui des principales collectivités territoriales et des entreprises appartenant, de près ou de loin, à la sphère publique.
La principale caractéristique de ce moule intellectuel est de privilégier toujours l’intervention publique. Même quand il s’agit d’encourager la création d’entreprises privées !
Depuis longtemps, la technocratie est dénoncée. Les anciens élèves des Grandes écoles, pépinières des grands corps de l’État, gouverneraient la France. Directement, ou par l’intermédiaire d’hommes politiques qui se sont placés dans leur sillage, tel Sébastien Lecornu, assistant parlementaire à 19 ans, conseiller technique à 22 ans de Bruno Le Maire (ENA, 1996-1998).
L’une des raisons de ce recrutement, si particulier à la France, d’un personnel politique largement issu des cadres de son administration pourrait résider dans le fait qu’aujourd’hui les carrières politiques sont souvent plus rémunératrices que celles cantonnées dans l’administration ou dans les entreprises privées.
Cette observation ne remet pas en cause la sincérité des convictions de nos élus. Elle explique simplement cette idéologie étatique dominante. Pourquoi ne pas privilégier des élus bénévoles ?
Mais là n’est peut-être pas le principal. Dans un pays voisin comme la Suisse, modèle universel de la démocratie directe, les élus en charge de l’exécutif (à tous les niveaux) sont plutôt mieux rémunérés. La différence est ailleurs : même exercées à plein temps, les fonctions électives sont à durée limitée, et, de ce fait, ne constituent pas un métier.
S’agissant des partis, la Suisse ne connaît que le financement privé (mais transparent) de ses formations politiques.
L’exercice d’un mandat électif ne s’inscrit pas là-bas dans une carrière, c’est un engagement civique temporaire. Tout est là, sans doute : de ce côté-ci du Lac Léman, l’opinion dominante admet que les élus doivent être des pros, tandis que, de l’autre côté du Lac, on privilégie leur engagement et leur proximité avec les citoyens. Il en résulte que, chez nous, près de la moitié des députés sont issus de la fonction publique, alors que c’est moins de 15 % chez eux…
C’est d’ailleurs en Suisse un principe institutionnel, dit principe de milice. Il désigne le fait que la majorité des fonctions publiques sont exercées à temps partiel, par des citoyens ordinaires, qui conservent leur activité professionnelle principale.
Limiter la professionnalisation du pouvoir politique, favorise donc le renouvellement des personnels et vivifie la démocratie.
Dans ce sens, un ensemble de mesures simples pourrait être pris en France :
– restreindre le droit à la disponibilité des fonctionnaires, s’agissant de l’exercice des mandats, à l’exception des communes rurales ;
– réduire certaines indemnités des parlementaires ;
Mais le plus efficace serait de permettre aux électeurs de contrôler eux-mêmes leurs élus, ou au moins leur travail, par le biais de pétitions ou de référendums.



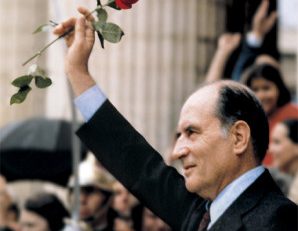


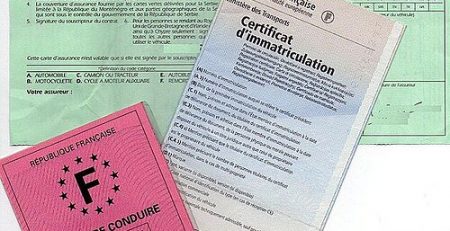


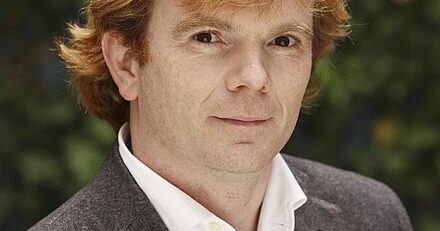

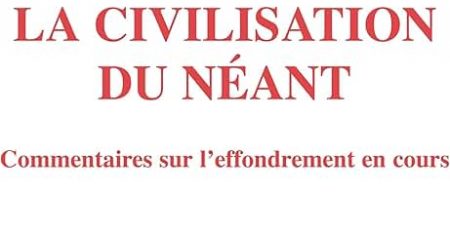
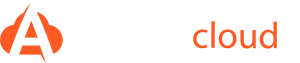
Laisser un commentaire