Réduire les dépenses publiques sans freiner la croissance
La France croule sous une dette publique de 114 % du PIB (2025) et un déficit de 6,2 % (170 milliards d’euros en 2024), avec des charges d’intérêt écrasantes de 65 milliards d’euros par an. La réponse du gouvernement à cette situation est d’augmenter encore et encore les prélèvements, au risque de créer une véritable crise à force de taxer ceux qui travaillent au bénéfice des parasites (y compris des parasites grassement payés dans les technostructures qu’elles soient locales, nationales, ou européennes).
Pourtant, des économies substantielles sont possibles en supprimant des structures et des dépenses inefficaces, tout en stimulant la croissance par une fiscalité allégée. Voici un plan en six points, inspiré par une analyse rigoureuse des finances publiques, qui permettrait d’économiser 70 à 90 milliards d’euros par an sans compromettre le bien-être des citoyens ni la dynamique économique.
- Remplacer les intercommunalités par des syndicats intercommunaux : 25 à 35 milliards d’euros d’économies
Les intercommunalités (communautés de communes, d’agglomération, métropoles), créées par les lois Chevènement de 1999, coûtent 80 milliards d’euros par an, dont 48 milliards pour le fonctionnement (salaires, indemnités). Elles ont remplacé les syndicats intercommunaux, des structures légères et efficaces qui géraient l’eau, les déchets ou les piscines pour moitié moins cher. Par exemple, un syndicat de 20 000 habitants dépensait 5 millions d’euros là où un EPCI en consomme 20 millions, souvent pour des projets politisés et détournés de leur objets initiaux : comme des voiries, au détriment de l’entretien des réseaux d’eaux usées.
En restaurant les syndicats intercommunaux pour les services techniques et en confiant urbanisme et vie locale aux communes, où les élus bénévoles réduisent les coûts, nous pourrions économiser 25 à 35 milliards d’euros par an à moyen terme. Cette réforme contrerait la métropolisation, qui asphyxie les villages au profit des villes-centres, et redonnerait du pouvoir aux citoyens ruraux, tout en maintenant des services de qualité grâce à la péréquation de l’État (27 milliards d’euros). En baissant les taxes locales (70 milliards collectés par les EPCI), les ménages consommeraient davantage, dopant la croissance sans creuser le déficit.
- Supprimer les régions : 10 à 15 milliards d’euros d’économies
Les 18 régions françaises coûtent 35 milliards d’euros par an pour gérer transports, lycées et développement économique. Cette couche administrative, souvent redondante avec l’État et les départements, alourdit les finances publiques sans bénéfice évident pour les citoyens. En supprimant les régions et en transférant leurs compétences aux départements ou à l’État, nous économiserions 10 à 15 milliards d’euros nets, après réorganisation.
Cette mesure simplifierait la gouvernance, réduisant les frais administratifs (14 milliards de fonctionnement régional). Une fiscalité régionale allégée (par exemple, sur les carburants) encouragerait l’investissement local, soutenant la croissance sans affecter les services essentiels comme les TER ou les écoles.
- Financer les associations par un crédit d’impôt : 5 à 10 milliards d’euros d’économies
Les subventions aux associations (25 milliards d’euros par an) soutiennent 1,8 million d’emplois, mais beaucoup d’organisations dépendent de fonds publics sans prouver leur utilité. En remplaçant ces subventions par un crédit d’impôt de 75 % pour les dons des citoyens, seules les associations plébiscitées (culture locale, aide sociale) survivraient. Les dons, actuellement de 8 milliards d’euros, pourraient doubler à 16 milliards, permettant une économie pour les finances publiques de 5 à 10 milliards.
Cette réforme responsabiliserait les citoyens, qui choisiraient directement les causes à soutenir, tout en libérant des fonds publics. L’impact économique serait neutre, voire positif, car les associations dynamiques attireraient plus de dons, stimulant l’engagement local sans alourdir la fiscalité.
- Supprimer les subventions à la presse et aux entreprises : 20 à 30 milliards d’euros d’économies
Les aides à la presse (1,5 milliard d’euros) et aux entreprises (40 à 50 milliards directs) faussent la concurrence et profitent souvent aux grands groupes. En supprimant les subventions à la presse, ou en les remplaçant par un crédit d’impôt pour les abonnements (0,5 milliard), nous économiserions 0,5 à 1 milliard d’euros. En ciblant les aides aux entreprises inutiles, notamment pour les grandes firmes (60 % des subventions), nous récupérerions 20 à 30 milliards d’euros.
Ces coupes favoriseraient un marché plus équitable, où les PME prospéreraient sans distorsions. Une baisse des impôts sur les sociétés (25 % en 2023) ou des cotisations sociales, financée par ces économies, relancerait l’investissement privé, alimentant la croissance conformément à la courbe de Laffer, qui prédit que moins d’impôts peut générer plus de recettes à long terme.
- Dissoudre le CESE et les commissions inutiles : 0,4 à 0,5 milliard d’euros d’économies
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et des centaines de commissions consultatives coûtent 0,5 milliard d’euros par an pour des avis rarement suivis. Leur suppression économiserait 0,4 à 0,5 milliard d’euros, un montant modeste mais symbolique. Cette mesure simplifierait l’administration sans impact sur les citoyens, libérant des fonds pour des priorités comme l’éducation ou la santé, tout en renforçant la confiance dans une gestion publique épurée.
- Conditionner les allocations à un travail : 15 à 20 milliards d’euros d’économies
Les dépenses sociales (250 milliards d’euros) incluent le RSA (15 milliards), mais aussi beaucoup d’autres aides décorrélées de tout travail et de toute cotisation antérieure. En conditionnant le RSA à un travail (par exemple, 15 heures par semaine) et les aides sociales à des cotisations préalables, nous économiserions 15 à 20 milliards d’euros. Cette mesure inciterait à l’emploi, réduisant la dépendance aux aides tout en allégeant les cotisations sociales. Il n’est pas normal de favoriser l’assistanat plutôt que le travail. Les pouvoirs publics, par lâcheté, ont trop souvent confondu l’assistanat et le social.
Pour minimiser l’impact social, des dispositifs d’accompagnement (formation, emplois publics) pourraient être financés par une fraction des économies, préservant la cohésion sociale. Une fiscalité sociale allégée stimulerait l’embauche, soutenant la croissance sans pénaliser les plus vulnérables.
Impact global : une révolution budgétaire au service de la croissance.
Ces six mesures permettraient d’économiser 70 à 90 milliards d’euros par an, couvrant les charges d’intérêt (65 milliards) et réduisant le déficit de 40 à 50 %, potentiellement sous les 3 % du PIB requis par l’Union européenne. En baissant les prélèvements obligatoires (43,5 % du PIB), notamment les taxes locales et les cotisations, ces économies libéreraient le pouvoir d’achat et l’investissement, conformément à la courbe de Laffer. Une croissance plus robuste (1 % prévue en 2025) générerait des recettes fiscales supplémentaires, évitant tout risque de spirale de la dette.
Contrairement aux idées reçues, ces coupes ne freineraient pas l’économie. Les syndicats intercommunaux, plus efficaces que les EPCI, garantiraient des services (eau, déchets) à moindre coût, tandis que les communes revitaliseraient les zones rurales, contrant la métropolisation. Les citoyens, libérés d’une fiscalité écrasante, consommeraient davantage, et les entreprises, affranchies des subventions biaisées, innoveraient dans un marché équitable.
Un appel à l’action
Les technostructures, souvent défendues par des études biaisées (réalisées par de hauts fonctionnaires vivant de ces technostructures), alourdissent nos finances sans servir les Français. En restaurant des structures légères comme les syndicats intercommunaux, en responsabilisant les associations via les dons, et en ciblant les aides inutiles, nous pouvons redonner du souffle à notre économie. Ce plan, audacieux mais réalisable, exige du courage politique pour dépasser les résistances. Réduisons les dépenses publiques, allégeons les impôts, et libérons la croissance : l’avenir de la France en dépend.











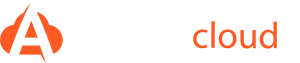
Laisser un commentaire