Sommet Trump-Poutine
Le 15 août, Donald Trump a reçu Vladimir Poutine à Anchorage en Alaska (clin d’œil de l’histoire : ce gigantesque 49e État des États-Unis a été acheté en 1867 à la Russie tsariste…).
On sait peu de choses, à l’heure où j’écris ces lignes, sur ce qui s’est dit lors de ce sommet – dont on ne connaît même pas vraiment l’ordre du jour.
Et les deux dirigeants ont suivi chacun leur tactique habituelle pour ne guère nous aider à comprendre les enjeux : Vladimir Poutine est resté silencieux sur l’essentiel, tandis que Donald Trump s’est enthousiasmé d’un probable futur accord… si le président ukrainien Zelensky le veut bien.
Bref, nous ignorons si un accord est proche et, plus encore, quelles en seraient les bases, le cas échéant.
En revanche, la tenue même de ce sommet est une étape importante.
Non pas parce que Poutine aurait ainsi rompu son isolement international, comme le disent en chœur les médias dominants – les pays africains ou les BRICS ont refusé avec constance de s’associer à la condamnation de la Russie par les pays occidentaux.
Mais bien parce que le principal soutien de l’Ukraine, les États-Unis, accepte de discuter avec l’agresseur.
Et que cette conversation se fait, pour la première fois, au plus haut niveau.
Ce dernier point manifeste que, là aussi à l’encontre de ce que disent les médias dominants, il n’est pas certain du tout que Vladimir Poutine soit décidé à « jouer la montre » : le fait qu’il ait participé en personne à ce sommet me semble montrer, au contraire, qu’il souhaite en finir avec cette guerre coûteuse le plus vite possible.
En tout cas, ce sommet montre d’abord que nous sommes revenus à la diplomatie « réaliste » : seuls les puissants ont voix au chapitre, les faibles – même quand ils sont les principaux intéressés, comme l’Ukraine en l’occurrence – n’y sont conviés que pour apposer leur signature à un accord négocié sans eux.
Mais, le principal enseignement de cette réunion est sans conteste le mépris dans lequel tous les interlocuteurs tiennent l’Union européenne, nain politique que l’on autorise bien volontiers à financer l’effort de guerre, mais non à travailler aux négociations de paix.
On nous avait pourtant assez annoncé que cette Union était indispensable pour nous permettre de « peser » sur la scène internationale. La réalité, c’est qu’en diplomatie, la France ou l’Allemagne seules pesaient davantage que l’UE, dont tous les observateurs – à l’exception manifestement d’Emmanuel Macron – voient bien combien elle est animée par des intérêts contradictoires.


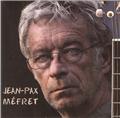
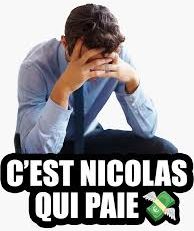
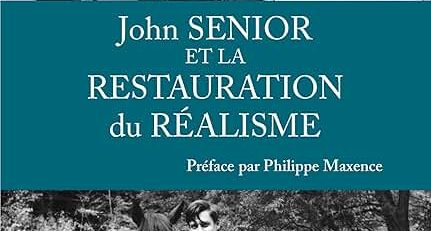

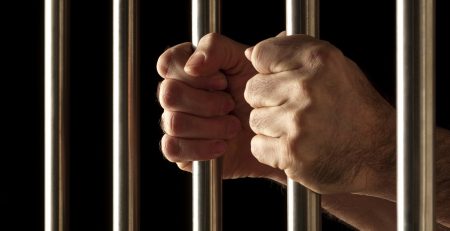





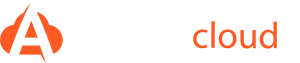
Laisser un commentaire