Taxe Zucman : gare aux totems fiscaux !
Voici plus de trois semaines, le Sénat avait rejeté une proposition de loi de gauche adoptée à l’Assemblée nationale visant à instituer une taxe assise sur le patrimoine des « ultrariches ». Comment ? Par le biais d’une « contribution différentielle » de 2 %, avec un « ticket d’entrée » pour une assiette fixée à 100 millions d’euros. Un dispositif simple et alléchant – ce qui est déjà un problème !
Il a fallu attendre la commission des Finances du Sénat et l’examen en séance publique pour que des arguments de bon sens soient opposés à ce texte qui a été rejeté par la chambre haute.
Petit retour sur cette tentative bloquée grâce à une chambre haute encore raisonnable et une jurisprudence du Conseil constitutionnel pour une fois bienvenue.
Tout d’abord, prévoir un simple prélèvement sans envisager de plafond soulève un problème constitutionnel : rien ne garantit la liquidité des contribuables qui risquent tout simplement de devoir se séparer d’une partie du patrimoine que l’on cherche à imposer. Pour taxer Pierre, il faudrait donc déshabiller … le même Pierre. C’est prendre le risque d’instituer un impôt confiscatoire. Ensuite, l’accumulation de biens divers, dont certains ont un faible rendement (les actions) ou qui n’appartiennent pas au contribuable taxé (les biens professionnels), n’est pas une garantie de solvabilité et entretient une confusion entre les notions de patrimoine, de richesse et de luxe. Elle pose une insidieuse présomption de richesse à l’égard de toute possession de biens, et même de détention (le problème posé par la prise en compte des biens professionnels). Enfin, une telle assiette soulève un problème de constitutionnalité car elle prend en compte des revenus fictifs ou latents, comme c’est le cas des actions : leur possession n’atteste pas l’existence de recettes ou de revenus puisque les dividendes sont incertains et aléatoires. On ne peut que s’étonner que la gauche, au nom d’une vision « justicialiste », oublie la prise en compte des capacités contributives, un paramètre utilement développé par le Conseil constitutionnel sur le fondement de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui reconnaît que, si « une contribution commune est indispensable », « elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».
Au fond, la gauche défend une vision statique du patrimoine, oubliant que la richesse est d’abord créée. En France, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a le mérite de poser la question de la justification d’un impôt au regard des capacités contributives du citoyen. Par ailleurs, il existe déjà des prélèvements sur les différentes cessions. Enfin, si on est cohérent, on peut aussi s’interroger sur ces impôts qui ne prennent pas en compte les capacités contributives des citoyens, comme la très douloureuse taxe foncière …
La situation de feu l’Impôt sur la fortune (ISF), dont les problèmes étaient multiples, aurait dû éclairer les esprits. Son faible taux (au maximum 1,5 %) lui a certes évité les foudres de l’inconstitutionnalité, mais il n’a pas empêché les difficultés quant à la détermination du patrimoine imposable. Des biens ont été imposés, mais sous certaines réserves comme la prise en compte du passif (le crédit contracté pour l’acquisition du bien), ce qui a conduit à des calculs complexes et à des rendements fort décevants. La détention d’une maison ne saurait faire oublier l’existence de prêts dont on est obligé de prendre le montant pour évaluer la valeur réelle du bien (cas aussi de l’IFI). Alors même que les associations savent que lorsqu’elles présentent leurs comptes, elles doivent envisager le passif, notion comptable curieusement oubliée dans cette tournure idéologique des débats. Le patrimoine devient un concept fourre-tout s’il n’est pas précisé. Bref, à défaut de bien gouverner, le « socle commun » aura évité le pire.
Jean-François Mayet
Politologue



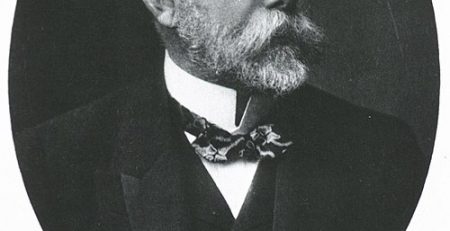

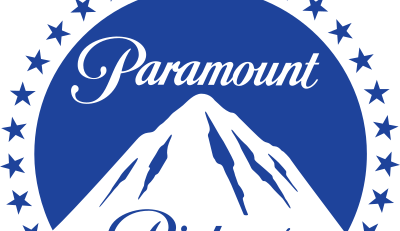






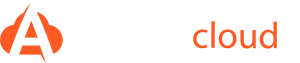
Laisser un commentaire